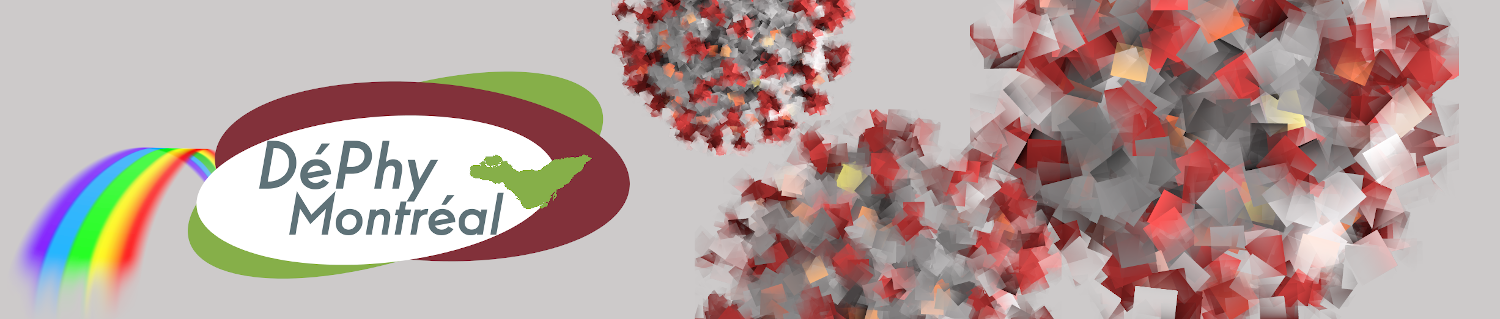Les constats du Protecteur du citoyen s’appuient sur une enquête impartiale et indépendante. Le rapport d’étape rendu public en décembre 2020* a mis en lumière les témoignages de personnes qui ont vécu la crise sur le terrain. Pour sa part, le rapport d’enquête final déposé aujourd’hui comprend notamment l’analyse de témoignages d’autorités gouvernementales et d’experts dans des domaines clés : gestion d’établissements de santé, gériatrie, gestion de crise, épidémiologie, prévention et contrôle des infections.
Parmi les causes d’une crise humaine sans précédent
En prévision de la propagation de la COVID-19 qui allait atteindre le Québec, les autorités gouvernementales ont tôt fait de placer les hôpitaux au centre de la crise. Pour libérer des lits en centre hospitalier, plusieurs usagers et usagères hospitalisés ont ainsi été transférés vers les CHSLD. Ces milieux de vie, déjà en sous-effectifs, étaient dépourvus des ressources nécessaires pour accueillir subitement des personnes fragilisées. Les décisions à cet égard ont donc été prises par des autorités qui n’étaient pas en mesure d’estimer adéquatement la capacité des CHSLD à remplir cette mission inédite.
D’autres facteurs ont contribué à la dégradation et à la désorganisation des services, comme la sous-évaluation par les autorités de la vulnérabilité au virus des résidentes et résidents en CHSLD. Les effets de l’absentéisme du personnel en raison de la propagation de la COVID-19 n’avaient également pas été prévus. La complexité de la tâche des équipes soignantes aurait dû être vue rapidement comme un motif de dérapage auquel il fallait apporter des solutions de façon urgente.
Durant les préparatifs à la pandémie, le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas évalué à sa juste gravité le fait que le personnel en CHSLD était peu familier avec les bonnes pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections lors d’une éclosion majeure. Prenant les lieux d’assaut, le virus n’a fait que confirmer cette méconnaissance aggravée par le manque d’équipements de protection individuelle et la vétusté des lieux.
De plus, l’absence de gestionnaires dans chaque CHSLD a souvent freiné les suites à donner « sur le terrain » aux consignes en constante évolution provenant des autorités sanitaires.
« La première vague aura prouvé, hors de tout doute, que les personnes proches aidantes en CHSLD doivent être accueillies au sein de l’équipe de soins et disposer des outils pour leur permettre de jouer leur rôle »
Quelques constats :
- Aucune action concrète et spécifique de préparation des CHSLD sur le terrain n’a été faite avant la mi-mars 2020.
- Les risques concernant ces milieux n’ont pas été correctement évalués.
- Le personnel de nombreux CHSLD ne disposait pas, en temps opportun, des équipements de protection individuelle (ÉPI) nécessaires pour freiner efficacement la propagation.
- Au plus fort de la crise, les CHSLD ont été privés de l’aide compétente de personnes qui connaissaient leurs proches respectifs et le milieu de vie.
- L’absence d’un gestionnaire local dans certains CHSLD faisait en sorte que l’information provenant du haut de la pyramide décisionnelle, transmise à une cadence accélérée, perdait bien souvent de son impact, voire de son sens.
- Les travailleurs de CHSLD dont la santé et la sécurité ont été mises à mal en raison du manque de matériel de protection approprié et du manque de formation sur son utilisation, étaient aussi à risque de contaminer les personnes hébergées.
Les recommandations du Protecteur du citoyen
Considérant l’ampleur de la crise de la première vague et ses répercussions dramatiques qui ont marqué le Québec, le Protecteur du citoyen recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en place différents outils, notamment :
- Une politique en matière d’évaluation et de gestion des risques concernant les CHSLD;
- Un plan détaillé de renforcement de la capacité des CHSLD à appliquer des mesures de prévention et de contrôle des infections;
- Une stratégie en matière d’approvisionnement en équipements de protection individuelle;
- Un plan provincial de déploiement de main-d’œuvre d’urgence dans le réseau de la santé et des services sociaux pour mieux tirer profit de l’apport de ressources en renfort;
- Des protocoles de déploiement de main-d’œuvre supplémentaire en contexte exceptionnel avec les ordres professionnels, les fédérations et les associations de professionnels de la santé et des services sociaux, les syndicats et les établissements d’enseignement;
- Une stratégie nationale de lutte à la pénurie de main-d’œuvre et de promotion des métiers et des professions dans le domaine de la santé et des services sociaux;
- Un plan d’action national visant à reconnaître la complexité de la prestation des soins et des services en CHSLD.
Toute réforme doit s’accompagner de la mise en place de systèmes d’information fiables et performants.
Pour conclure, le Protecteur du citoyen recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux de proposer l’instauration d’actes de commémoration annuelle des victimes de la COVID-19 dans les CHSLD et des personnes qui ont travaillé directement ou indirectement auprès d’elles. Il est important de garder en mémoire ce que ces personnes ont vécu afin que cela soit le moteur d’actions et de changements durables.
Le Protecteur du citoyen demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de lui faire un suivi de l’état d’avancement de l’implantation des recommandations au 1er mars 2022, puis, selon un échéancier à convenir. Le Protecteur du citoyen entend faire état de ces suivis dans son rapport annuel d’activités, et ce, jusqu’à l’implantation, à sa satisfaction, des recommandations.
- Consulter le Rapport La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie — Cibler les causes de la crise, agir, se souvenir.
- Visionner le Message vidéo de la protectrice du citoyen.
*cf CHSLD: Rapport d’étape de la Protectrice du citoyen.
Dans les médias
- « Il faut repenser les soins donnés en CHSLD »
Les articles suivants font le lien entre les conclusions de la Protectrice et le volet national de l’enquête du coroner :
- Rapport dévastateur sur les CHSLD – La protectrice du citoyen contredit le gouvernement Legault
- Les CHSLD n’étaient dans aucun scénario de départ au Québec, souligne la protectrice
- Rapport de la protectrice: rien n’avait été fait pour préparer les CHSLD
- CHSLD: il n’y avait aucun plan avant la mi-mars, dit la protectrice du citoyen
- Les CHSLD pris en compte «dans aucun scénario» à l’arrivée de la COVID-19
- Rapport accablant de la protectrice du citoyen | « On s’est concentrés sur les hôpitaux », admet McCann
- Décès dans les CHSLD : Danielle McCann se défend d’avoir tardé à agir
- Quebec ‘cast aside’ seniors in long-term care, needs to make changes now, ombudsman says
- Quebec ex-health minister under fire for focus on hospitals over long-term care